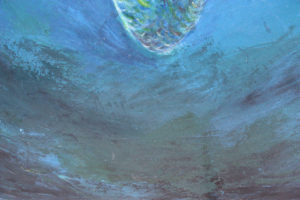Cette semaine, je vais continuer à écrire sur notre rapport au temps. Je n’ai pas que cela à faire, non, je trouve juste que c’est le bon moment pour le « vivre à propos ». Ce qui va me ramener à Montaigne. Mais je vais aussi évoquer tout ce qui me paraît indispensable et qui ne se trouve pas dans des cases à cocher. En particulier, rire et écouter de la musique.
Commençons par cela, rire, car cette semaine la situation me donne des accès d’humour noir, à défaut d’humeur. J’ose à peine écrire que l’annonce de 499 morts de plus en 24h en France, au soir du mardi 31 mars, m’a fait penser à un mauvais plan marketing de Frédéric Beigbeder pour lancer un nouveau livre. C’est mon seuil psychologique de l’absurde, j’imagine. Ce sont des choses qu’on ne devrait pas dire, car cela manquerait de respect au sérieux de la situation et à ceux qui souffrent ? Si le réel est déjà horrible en soi, autorisons-nous la dérision, c’est aussi une force qui nous fait tenir debout. Pour citer Aragon (dans « il ne m’est Paris que d’Elsa ») : « je ne veux plus pleurer, car pleurer nous désarme et c’est bon pour un Dieu de plier le genou ». Homo sum, donc, acte.
Non, je ne pleurerai pas, comme je ne voulais pas pleurer devant le corps froid de mon Père, quand je récitai tant bien que mal et la gorge nouée, en 2016, cet autre poème d’Aragon – en temps de guerre celui-là – « il n’y a pas d’amour heureux ».
Non je ne m’habillerai pas de noir et je ne ferai pas triste mine et je ne suis pas d’accord avec ceux qui en sont presque à vouloir interdire les plaisanteries du 1er avril (en passant merci à la libre Belgique de son article « les poissons d’avril sont reportés d’un mois… ou plus »).
Oui, je veux rire, continuer à rire, parce que c’est continuer à vivre. Je veux mes blagues du premier avril et tant pis si elles sentent le poisson faisandé pour certaines. Perdre la capacité de rire serait perdre aussi la distanciation, le recul nécessaire et la capacité à ne pas surréagir à l’ironie et à la dérision. Sans distance, tout peut paraître offense. N’oubliez pas le 7 janvier 2015.
Je vous saurais gré, en cette époque, de prendre au pied de la lettre la phrase suivante : mettez de la distance partout. N’en voulez surtout pas à ceux encore capables de rire, car comme l’a écrit si bien yasmina khadra « Si tu veux pleurer, pleure ; si tu veux espérer prie, mais de grâce, ne cherche pas de coupable là où tu ne trouves pas de sens à ta douleur »
De toute façon, le problème n’est pas de faire des blagues déplacées, trop décalées ou vécues comme « offensantes » en période de confinement. Ce dernier ne fait que mettre tout en relief dans les huis clos propices aux clairs-obscurs. En écrivant cela, je me rappelle de la liste des livres que je songe à proscrire pour la période : Sartre (huis clos, comme si on y était pas déjà), Barjavel (ravage, je n’ai vraiment pas aimé la fin patriarcale), Camus (la Peste, bon comme on la porte déjà en soi…), tristes tropiques (ce Lévi-Strauss qui nous « arrache à la pauvreté de nos rues et de nos immeubles » selon Bataille, va nous faire encore plus ressentir la petitesse après coup), les Mots et les Choses (Foucault, je risque d’être conditionnée pour mon pied de la lettre), rue des maléfices (de jacques Yonnet, si beau, mais trop douloureux à lire quand on rêve de parcourir Paris désertée), j’avoue que j’ai vécu (Neruda, non parce qu’il nous fait voyager en esprit dans des jungles luxuriantes, mais parce que je l’ai aimé passionnément à 18 ans pour me rendre compte plus tard que même un grand poète peut être, à certains égards, un triste homme).
Bon j’arrête là, mes parenthèses dans la parenthèse débordent. À la réflexion, je ne mettrai pas Neruda à l’index. Je ne parlerai pas de Borges, de Buzzati (en ce moment précis) de Christian Bobin et de Manuel Vazquez Montalban, que je vais relire. Mais n’en disons pas plus. Parce que quand on parle des livres, finalement on ne parle que de soi. Et quand on est confiné, parler de soi a très rapidement un air de déjà-vu.
D’ailleurs, voilà où je voulais en venir. Le confinement nous tend des miroirs. Sur nous, sur notre société, et comme nous sommes un peu enfermés avec, nous finissons par les regarder. C’est une sorte de lanterne magique qui jette un éclairage fantasmagorique sur la réalité. C’est toujours étrange, mais ce n’est pas toujours beau à voir. C’est pour cela que l’humour peut nous sauver. Encore faudrait-il que nous prenions le temps de l’apprécier, de lire les messages entre les lignes, de ne pas tout prendre au pied de la lettre …
C’est justement cela le prétendu problème avec les poissons d’avril, et ça ne date plus d’hier (au pied de la lettre au moment où j’écris cette ligne). Un article des décodeurs du monde soulignait déjà l’année dernière que 6 internautes sur 10 partagent une information sans l’avoir lue, et citait un simple poisson d’avril qui avait fini en rumeur malveillante persistante.
L’exemple est aussi beau que Christine Boutin reprenant une phrase du Gorafi en 2014. Il n’y a pas que pleurer qui nous désarme, rire aussi et c’est plus agréable. Surtout quand on est à deux doigts de pleurer de rire.
Donc, en tant de confinement, de doutes et d’anxiété, c’est encore pire qu’avant, les gens prennent tout au pied de la lettre, ou ne croient que ce qui les arrange.
Ce qui veut dire également, si j’ai bien lu tout l’article des décodeurs, y compris les liens sur lesquels il pointe, que très peu de gens liront jusqu’au bout ce que je suis en train d’écrire et que peu comprendront quand je suis ironique, ou pas.
Ce n’est pas comme si cela allait changer quoi que ce soit. Très peu de gens me lisent, tout court. Mes chroniques sont trop longues. Ils n’ont pas de temps à perdre. Notez bien que je n’estime jamais « perdre » du temps, quant à moi. Cela supposerait que je pourrais en gagner. Or le temps, dans mon univers, est une dimension que je ne possède pas. Il passe indépendamment de moi. Je peux toujours vouloir mettre du temps de côté pour faire quelque chose, ce sera toujours celui de demain, celui que je n’ai pas encore et que j’espère encore avoir. Quand on passe son temps sans l’occuper, le temps reste toujours à la fois une peur et un espoir, l’un toujours lié à l’autre.
Par les temps qui courent, on devrait pourtant marquer un temps d’arrêt et prendre le temps de « vivre à propos », pour citer Montaigne ; à méditer pour la douceur de vivre en confinement.
« Il faut apprendre à souffrir ce qu’on ne peut éviter. Notre vie est composée, comme l’harmonie du monde, de choses contraires et de divers tons, doux et âpres, aigus et plats, mols et graves. Le musicien qui n’en aimerait que les uns, que voudrait-il dire ? Il faut qu’il sache s’en servir en commun et les mêler. Et nous aussi les biens et les maux, qui sont consubstantiels à notre vie… » […] Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Nature a maternellement observé cela, que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses, et nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par l’appétit : c’est injustice de corrompre ses règles. […] Nous sommes de grands fous : « Il a passé sa vie dans l’oisiveté, disons-nous ; je n’ai rien fait d’aujourd’hui. – Quoi, n’avez-vous pas vécu ? C’est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Ah ! si on m’avait donné l’occasion de traiter de grandes affaires, j’aurais montré ce que je savais faire. – Avez-vous su méditer et conduire votre vie ? Alors vous avez fait la plus grande besogne de toutes. […] Composer nos mœurs est notre office, non pas composer des livres et gagner des batailles et des provinces, mais l’ordre et tranquillité à notre conduite. Notre grand et glorieux chef-d’œuvre, c’est vivre à propos … » Montaigne, Essais (III, 13, 1107)
À propos de vivre, je ne suis pas hors du temps, ni de mon temps, j’essaye d’en saisir l’air pour qu’il m’inspire. J’ai quelques difficultés à respirer en ce moment. Franchement, avril ne m’a jamais aimée et je suis en froid avec le printemps. Cela dit, en toutes saisons, le temps ne m’a jamais attendue pour s’écouler et il peint à sa manière, sur mon visage et mes rêves, les traces de son passage. C’est un portraitiste sans concession.
Puisque me voilà, dans le fil de mes réflexions sur le temps, à aborder la peinture, je pense que tout peintre a une profonde aversion pour la question : « combien de temps avez-vous mis pour faire cette toile ? ». Hé quoi, que voulez-vous mesurer : le temps de l’imagination, le temps du geste ou le temps d’apprentissage du geste juste, l’exactitude ou la capacité à générer une « impression » ? La valeur d’une peinture s’estimerait au temps passé ? Comme un artisanat industrieux où on disposerait d’unités d’œuvres ?
J’ai souvent en tête une anecdote mettant en scène le peintre Turner (d’aucuns l’ont plus tard attribuée à Picasso, mais je donne plus de crédit à l’hypothèse Turner), avec une admiratrice :
« Combien de temps cette toile vous a pris ? » lui demanda la dame.
« Une heure”, répondit Turner.
“Une heure ! » S’exclama la dame. « Mais comment osez-vous la vendre à ce prix exorbitant ? »
« Ma chère dame, il m’a fallu vingt ans pour être capable de peindre cette toile en une heure, » lui répondit Turner.
Personne ne possède le temps, ni vous ni moi, je ne peux le perdre et vous ne pouvez pas le gagner. A quoi attachez-vous du prix, hors les étiquettes ?
Il est, il a été et il sera toujours temps d’en rire, car c’est ce qui nous reste en propre, inlassablement, pour nous rappeler de l’humanité quelque chose dont on ne peut être dépossédé.
Alors je ris. Sur l’air du Faust de Gounod. Sur l’air du Stabat Mater de Pergolesi (si.), avec l’orchestre de Nathalie Stuzmann. Je ris sur la danse macabre de Saint-Saëns, sur l’air du froid du roi Arthur de Purcell, je ris sur la symphonie fantastique de Berlioz, sur la symphonie n°9 de Beethoven, sur le requiem en ré mineur de Mozart, sur l’air de la reine de la nuit de la Flûte enchantée. Puis je ris sur l’air du Bolero de Ravel, joué par les musiciens confinés, je ris en écoutant mes fils jouer, qui du piano, qui de la guitare, je ris sur tous les airs partagés, par des amis et des inconnus.
Et mon rire de grinçant et noir se fait tendre et gai, car la musique fragmente les murs, fait entrer la lumière dans mon cerveau assombri, éclate le confinement et l’anxiété.
Et peu à peu, je ne grince plus, je ris et je dis merci. Merci pour la musique.
Pas pour le poisson, ça a déjà été pris par Douglas Adams.