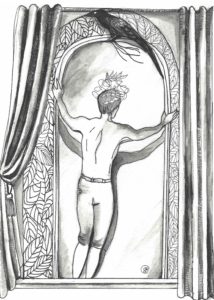La destruction créatrice, au sens où on l’entend actuellement, n’existe pas. C’est une foutaise. Une idée qui ne peut sortir que de la tête d’économistes. Leurs modèles du monde n’ont jamais empêché ce qui se produit aujourd’hui. Pire, ils y ont contribué, en prenant pour acquis des axiomes imbéciles, ou en cherchant à convaincre, pour leur propre renommée, de leurs capacités à réduire la complexité du monde à des représentations simplistes, au pouvoir magique de justifier l’injustifiable. Nous détruisons ce monde, petit à petit, sans la moindre idée de ce que nous créons à l’échelle de l’humanité. Si nous appelons destruction créatrice une balance qui se voudrait positive dans l’avancée du progrès, en supputant que l’évolution humaine remplace des modèles obsolètes par des modèles aux impacts durablement plus bénéfiques pour l’espèce et l’écosystème dont elle dépend, pouvons-nous vraiment affirmer qu’elle existe, de par ses effets? Pouvons-nous affirmer que notre espèce et ce monde se portent bien ? Sinon, progressons-nous vers ce but? C’est à dire pouvoir garantir d’un côté, durablement, des conditions de vie dignes (au sens biologiques, sanitaires et sociales), des possibilités d’accès à la connaissance, d’éducation libre et d’ouverture spirituelle pour tous les individus de l’espèce et de l’autre, garantir un équilibre entre cette espèce et son écosystème en préservant ce dernier?
Le glorieux chef-d’œuvre de l´homme, c´est vivre à propos
Montaigne
Vivons-nous à propos aujourd’hui, incapables que nous sommes de vivre dans la voie de l’équilibre? Montaigne l’a-t-il fait toute sa vie, lui qui a vécu la Saint-Barthélemy? Il était horrifié par les guerres de religion de son temps. Il avait de quoi. Certaines choses de notre époque, du vingtième ou du vingt et unième ne sont pas moins terrifiantes. L’échelle est différente, les bouleversements aussi. Mais les souffrances et les raisons de s’indigner, sont tout aussi réelles, multiples et profondes. Je ne sais pas si je comprends mon époque comme il a essayé de comprendre la sienne, et jusqu’à quel point je peux la comprendre. Le paradoxe étant qu’ayant vécu moins de violences, j’en connais pourtant plus. Dans tous les cas, pour lui faire hommage, je ne peins pas l’être, je ne peux peindre que le passage. Ce que je connaîtrai de l’être ne pourra s’inscrire que dans l’espace de mon passage, des connaissances et des événements de mon temps, ainsi que de mes capacités de perception et de compréhension. L’être, en tant qu’être, est une totale abstraction. Car l’impermanence est l’état de ce qui est.
Dans l’art, la destruction n’engendre pas la création et la création n’empêche pas la destruction. Tout au plus peut-on créer pendant la destruction, pour essayer de témoigner du temps ou d’un autre temps, pour rêver, pour regarder ou sublimer la réalité, pour montrer les ombres de nos cavernes ou ce qui se cache derrière. La vie est un processus de destruction. L’image de sa fin se construit en même temps que la conscience de notre identité propre. Nous créons pour échapper à notre condition humaine, ou lui donner un sens, ou tromper nos cauchemars. Nous créons pour nous survivre. Quand nous ne savons pas créer, nous détruisons. Le tout pour dire, d’une certaine manière, «nous sommes passés dans ce monde ».
Ceci autrefois s’inscrivait dans la durée, avec l’idée de laisser une empreinte. Tout se passe aujourd’hui comme si seul le processus de destruction s’accélérait face au processus de création et que tous y contribuaient davantage, en cherchant à s’approprier un instant d’immortalité.
Quel but poursuit celui ou celle qui se photographie devant le David de Michel-Ange et l’instant d’après le contenu de son assiette? J’étais là? Cette statue me met bien en valeur? J’ai bien mangé? Ceci n’aura jamais d’autre intérêt que d’occuper l’espace de leur vie et l’espace d’un instant dans leur vide. Nombreux sont ceux qui se pressent pour voir ce qui est supposé devoir être vu, et qui n’en voient rien, n’en pensent rien, trop occupé d’être vus à regarder. En cela ils sont monstrueux d’ignorance, car ils cherchent à se montrer, plutôt qu’à comprendre ce qu’ils font et pourquoi. S’ils pouvaient, ils reviendraient avec un morceau de quelque chose à possèder, sans se soucier de ce qu’ils détruisent dans leur désir de possession. Ainsi périssent les coraux.
Les limites de la décence sont vite franchies quand tous estiment que leur dignité seule importe, bien qu’ils ne sachent, ni la définir, ni la situer.
Cocteau disait, le tact dans l’audace, c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin.
L’immense talent de l’acrobate c’est de frôler le risque tout en gardant la maîtrise et faire croire à la facilité et la souplesse là où tout n’est que tensions et répétitions, efforts inlassables. L’incroyable chance de l’idiot c’est de trouver des imbéciles pour croire à son talent, lorsqu’il va trop loin sans rien maîtriser et qu’il arrive, fortuitement, à ne pas tomber. Il recommencera à oser parce qu’il oublie ses échecs aussi vite que ceux qui le suivent. Son assurance est son seul effort permanent et l’aune à laquelle il est jugé. Ceux qui osent aujourd’hui ne sont pas les bons, tandis que la colère des imbéciles emplit le monde d’une obscurité bruyante. Ce qui vient ce sont les ténèbres de l’ignorance, que la médiocrité baptise pompeusement, à nouveau, visage du futur.
L’époque n’a pas de tact. On le voit à ses scories, ses présidents, ses discours, ses foules, comme des nuées d’étourneaux qui ne voient que sur un seul plan et se meuvent par perturbation, non par réflexion. Je ne sais à cet instant de l’histoire, chers Montaigne et Cocteau, s’il faut en rire ou passer de l’autre côté du miroir, chercher une échappatoire à la réalité dans l’art. Mais quelle réalité et quel art? Tout ceci n’est que jugement, affaire de perspectives. L’art pour l’art est un fantasme. On ne crée pas pour le seul amour du beau car il n’existe pas d’absolu du beau ni de beauté universelle, pas plus que la notion « d’homme civilisé» ne peut traverser tous les clivages. L’art est un triple langage qui joue sur les effets de lumière, le langage des signes et le langage de nos daïmôns. Il y a toujours un autre regard à trouver dans les visages de l’art qui nous sont montrés.
On crée avec le bagage d’un système de valeurs et d’une époque, mais aussi et surtout avec nos émotions. La poésie et le mystère d’un tableau comme la tempête, de Giorgione, nous touchent profondément encore, nous questionnent, quand bien même nous n’en saurions reconnaître les signes. Est-ce là une œuvre liée au songe de Poliphile, lequel aurait aussi inspiré les jardins de Bomarzo ? C’est probable, mais nous ne le savons pas, et nos contemporains sont très peu à avoir lu l’ouvrage. Quelle importance quand, malgré tout, chacun peut se sentir happé par le regard de la femme ou l’éclair lointain qui tous deux racontent une histoire, celle qui aurait pu être la nôtre dans la construction d’un monde apaisé. C’est une autre trame qui s’écrit.
Que sait-on de Giorgione ? Quelques lignes et bien moins que cela. Ce n’est pas lui qui survit dans les romances à son sujet. On ne se survit pas dans l’art, il n’est que l’allégorie des reflets du monde que l’artiste perçoit. Contempler une œuvre, c’est regarder une sorte d’ombre dans une sorte de miroir et ne voir ni ne comprendre, que ce que nos sens et nos connaissances nous autorisent.
L’art, c’est ce qui nous aide à «préserver le souvenir de la bruyère» (Camus dans Prométhée aux enfers) quand tout semble voué à le faire disparaître. C’est ce qui nous fait effleurer l’idée de cette humanité réconciliée, en harmonie avec elle-même et la nature, qui me semble désormais une illusion, mais qui reste un idéal. Renoncer à l’art, ce serait renoncer à cet idéal et uniquement survivre.
L’art n’est pas rationnel, pas plus qu’il ne donne le pain quotidien, mais il nous aide à penser et à grandir à l’aune du travail de l’artiste, quand il a donné pour nourrir son œuvre, une livre de chair et de sang et tous les matins du monde, ou même rien qu’une étincelle, mais une étincelle d’âme. Tout artiste est un acrobate et c’est l’effort, la tension, l’apprentissage du geste ou du mot juste, la mémoire d’une armée d’anges dans la chute d’un cil, qui créent la fulgurance.
Un art façonné sans émotion humaine, sans lutte ou sans effort avec l’esprit et la matière (quelle qu’elle soit) pour en tirer l’éclair, la forme signifiante qui saura durer dans l’espace et le temps, est un artifice. Il peut être, au mieux, décoratif ou distrayant. Mais ceci est totalement subjectif. On peut être spolié de l’art comme on peut être spolié de l’essentiel, quand on nous dit ce que l’on doit créer ou aimer. L’art, c’est le cri du plus que vivant modulé pour traverser nos mémoires. A chacun de lui donner ou lui trouver sa signification et son véhicule (mots, corps, peinture, sculpture, dessins, céramique, musique et chants, jardins, architecture, …), sans se soucier des classifications.
Dans une époque plus que jamais vouée à l’inutile, au dispendieux, à la surconsommation, l’excès d’individualisme et le gâchis, il est parfois difficile de discerner encore l’art, ou l’intérêt de l’art, dans la surenchère des images et des émotions factices. L’ensemble est une vaste distraction dans le train qui nous mène à l’abime. Est-ce que l’art peut empêcher cela ? Non, mais il n’en restera pas moins indispensable, pour que nous apprenions à grandir et à penser, à imaginer, au-delà des brumes des slogans, des matraquages politiques et publicitaires, des histoires ré-écrites et des images toutes faites. Parce qu’il nous donne le pouvoir d’avoir d’autres émotions que celles vers lesquelles on nous mène, et c’est la seule chose réellement en notre possession.
Ceux qui dans l’art entendent le cri des poètes, le cri des plus que vivants, entendent les accoucheurs d’espoir, et portent la lumière aux bords des ténèbres. Il faut lutter contre l’immense envie de se taire quand toutes les révoltes, toutes les rages, tous les désespoirs et toutes les colères des porteurs de lumière, ne valent même plus un pleur de chandelle, un mot, une épitaphe, quelques broussailles dans un jardin de bruits cimenté d’oubli. Nous n’avons pas à nous sentir perdus dans l’immense friche de ces échanges absurdes où les gens n’échangent rien d’autres que leurs propres certitudes et l’envie de croire que même la bêtise peut être une posture intelligente. Nous n’avons pas à nous y sentir perdus quand ce n’est pas notre jardin, ni notre lieu de promenade. Notre jardin, c’est notre cri de vie. Nous devons apprendre à le moduler, toujours, inlassablement, ce cri qui nous fera deux fois vivants. Nous devons crier la création malgré la destruction et voir l’une et l’autre indépendamment, en hommes et femmes libres d’esprit. Nous devons crier encore plus, quand nous sentons venir ces temps où l’art sera impuissant.
Si l’art nous est indispensable, ne le pleurons pas en supposant qu’il n’est pas de cette époque, vivons le selon notre entendement, dans l’émotion qu’il nous procure, à tout instant. Qu’importe d’être compris ou non. Nous crions pour libérer le vivant et «vivre à propos. Tout le reste, gouverner, amasser, bâtir, n’est qu’accessoire et secondaire» (Montaigne).